2 - Géopolitique de l’"Etranger proche"
Par , le 14 mai 2024 


Laurent Chamontin (1964-2020), était diplômé de l’École Polytechnique. Il a vécu et voyagé dans le monde russe. Il est l’auteur de « L’empire sans limites – pouvoir et société dans le monde russe » (préface d’isabelle Facon – Éditions de l’Aube – 2014), et de « Ukraine et Russie : pour comprendre. Retour de Marioupol », éditions Diploweb 2016.
Longtemps avant la relance de la guerre d’agression russe le 24 février 2022, Laurent Chamontin (1964-2020) a vu juste sur la Russie de Poutine et ses ambitions impériales à l’encontre de l’Ukraine. Il fait partie des quelques experts qui ont mis à disposition des faits à considérer et des analyses à intégrer pour ne pas être surpris. En accès gratuit, le Diploweb a publié dès août 2016 son ouvrage « Ukraine et Russie : pour comprendre. Retour de Marioupol ». L. Chamontin alertait non seulement sur les visions impériales de Moscou mais aussi sur les dangers de la désinformation russe, (Cf. Chapitre 6. « La guerre de l’information à la russe, et comment s’en défendre »). Créé en 2021, le Service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (Viginum) ne cesse depuis de mettre à jour des actions de désinformation russes à l’encontre de la France. Chapitre par chapitre, la publication numérique de l’ouvrage de L. Chamontin a été achevée en février 2017 par le chapitre « Le rôle crucial de l’Europe dans la résolution de la crise ukrainienne ». Après la publication numérique gratuite, le Diploweb en assuré la publication aux formats Kindle et livre papier, par Amazon. Sous ces trois formats, le livre « Ukraine et Russie : pour comprendre. Retour de Marioupol » a reçu un bel accueil. Ce dont témoigne d’ailleurs en creux sur Amazon la hargne de quelques trolls pro-russes aux commentaires pathétiques, hommages involontaires à la pertinence d’une pensée critique argumentée et toujours nuancée. Ce qui les gêne, c’est la mise à disposition d’éléments de connaissance qui réduisent l’efficacité de leurs manipulations mentales.
Laurent Chamontin est décédé le 15 avril 2020 de la combinaison d’un cancer et du Covid-19. Il nous manque humainement et intellectuellement tant sa lucidité aurait été la bienvenue pour éclairer la relance de la guerre russe en Ukraine. Cette dernière exerce des effets de long terme sur la reconfiguration stratégique de l’Europe géographique. C’est pourquoi il est utile de (re)lire un auteur qui avait su en distinguer les signes annonciateurs. La grâce de l’écriture et les possibilités de la publication internet permettent de remettre en avant son analyse contextualisée, puisque chaque page HTML porte en pied la date de publication initiale. Chacun saura trouver dans ces lignes rédigées en 2016 des réflexions pour aujourd’hui.
—
La chute de l’URSS, en décembre 1991, a fait émerger une nouvelle réalité géopolitique, « l’Étranger proche », entre la Russie et l’Europe centrale. Jusqu’à aujourd’hui, les pays de cette zone doivent compter avec un voisin russe incontournable et resté fort jaloux de sa prérogative impériale. Les américains et les européens, de leur côté, y ont développé de nouveaux liens et placé de nouveaux pions, avec un bonheur inégal. Retour sur une relation tumultueuse qui a bien sûr contribué à la crise actuelle, même s’il est très exagéré de parler de « menaces » à l’encontre de la Russie.
LA CRISE ukrainienne repose crûment la question de la marge de manœuvre dont disposent les pays de « l’Étranger proche », cette zone tampon qui, selon le dictionnaire russe de référence [1], se compose de l’ensemble des anciennes républiques soviétiques non russes.

« L’Étranger proche » : propagande impériale ou réalité stratégique ?
C’est à un objet étrange et fondamental que nous avons affaire avec ce discret oxymore : une trouvaille sémantique qui renvoie à un passé commun, et en même temps à la nostalgie du temps où la Russie était le centre d’un empire qui n’avait pas encore éclaté. Que le terme devienne proverbial au début des années quatre-vingt-dix dans la bouche du ministre russe des Affaires étrangères n’est évidemment pas un hasard [2], alors que les forces centrifuges identifiées par H. Carrère d’Encausse en 1978 [3] finissent d’achever l’URSS.
Du fait de cet éclatement, il ne faut pas attendre de la notion d’Étranger proche qu’elle dise grand-chose de chacun des pays auxquels elle fait référence : que l’on considère la démographie, le niveau de développement économique ou la culture politique [4], c’est la disparité qui domine, des pays baltes à l’Asie centrale en passant par le Caucase, l’Ukraine, la Biélorussie et la Moldavie.
Si l’on ajoute à cela la diversité des situations géopolitiques (influence chinoise à l’est, européenne à l’ouest, turque et iranienne au sud, et aussi, dans ce dernier cas, la pénétration islamiste [5]), on peut être tenté de se poser des questions sur l’intérêt qu’il peut y avoir à conserver cette expression dans le vocabulaire des relations internationales… au risque de méconnaître qu’elle a effectivement un sens du point de vue russe.
Il faut d’abord noter à cet égard que la disparition de l’URSS n’empêche nullement la persistance d’un espace relativement intégré qui s’enracine à la fois dans la géographie et dans l’histoire. Y contribuent le statut de lingua franca conservé par le russe et la présence de minorités russes dans toutes les républiques. Intervient aussi la rémanence du modèle politique russe, caractérisé par un État qui ne se reconnaît pas de responsabilités vis-à-vis de la société dont il émane, avec ce que cela entraîne : corruption, inefficacité, captation des ressources par des oligarques…
Il faut également compter avec l’intégration économique de l’ancien espace soviétique, que ce soit par le biais des flux migratoires vers une Russie relativement riche par rapport à ses voisins, ou par celui des échanges de biens via des circuits et des infrastructures communes qui n’ont pas disparu, loin s’en faut.
On mentionnera enfin – par exemple dans le cas des gazoducs biélorusses et ukrainiens – le rôle crucial des anciennes républiques dans le transit des exportations russes, inséparable d’une configuration géographique qui fait de la Russie une puissance continentale excentrée.
À l’issue de ce rapide survol, nous pouvons nous faire une meilleure idée de ce qui confère son unité à l’Étranger proche : celui-ci apparaît comme la zone d’intérêts vitaux par excellence de la Russie, une zone dont la cohésion paradoxale est matérialisée par les multiples points d’appui que le Kremlin entretient loin de ses frontières, du Kirghizstan et du Tadjikistan à Kaliningrad, en passant par l’Arménie et bien sûr la Crimée et la Transnistrie.
Il importe à ce point de souligner que « zone d’intérêts vitaux » et « zone d’influence exclusive » sont deux concepts tout à fait différents : en pratique, les influences russes sont loin d’être seules à s’exercer dans l’Étranger proche – c’est une autre manière de dire que l’URSS a disparu.
De ce fait, si l’État russe, structuré à partir d’un centre isolé se projetant dans toutes les directions, connait un problème très spécifique de contrôle de ses débouchés, il ne s’ensuit pas par exemple que le transit par les gazoducs ukrainiens doive nécessairement se traduire par l’assujettissement de l’Ukraine.
La source de la crise actuelle n’est donc pas tant un supposé déterminisme géographique que la difficulté qu’il y a à dépasser les antagonismes et à établir avec le Kremlin une relation de confiance dans l’Étranger proche ; en contrepoint, l’accord signé en 1863 par la Belgique et les Pays-Bas pour assurer l’accès au port d’Anvers à partir de la mer du Nord, accès qui suppose de transiter par les eaux territoriales néerlandaises, paraît bien relever d’une autre sphère culturelle.
Russie et États de l’Étranger proche : une asymétrie structurelle
Avant de passer à l’examen des comportements des acteurs occidentaux, il importe de mentionner un thème très riche, parmi les facteurs qui entretiennent la défiance entre la Russie et ses voisins, celui de la différence de taille et de statut entre celle-ci et ses voisins.
Il y a ici une asymétrie qui est pour partie inévitable, en premier lieu sur le plan stratégique : cohabitent d’un côté un pays continent nucléarisé, toujours animé d’un désir de puissance, pour qui l’option du repli sur soi reste toujours plus ou moins viable, et de l’autre des États qui, eux, ne peuvent ignorer leur puissant voisin. C’est l’une des hypothèques qui pèse par exemple, sur l’Union Économique Eurasiatique, dans laquelle l’égalité du Kazakhstan et de la Biélorussie avec leur partenaire russe peut difficilement être autre que formelle, tant le poids de cette dernière est écrasant, surtout si on pense que la géographie l’interpose fatalement entre les autres membres.
Cet état de fait complique d’autant plus l’instauration de la confiance que la Russie est actuellement en plein traumatisme post-impérial. Le recul de celle-ci en termes de puissance relative au XXIe siècle, à l’issue de l’effondrement extrêmement brutal de l’URSS, ne la prédispose pas, c’est le moins qu’on puisse dire, à accorder spontanément sa considération à des États jeunes de taille plus restreinte que la sienne, d’autant que ceux-ci ont joué un rôle déterminant dans le processus d’éclatement de l’Empire.
C’est le cas en particulier de l’Ukraine, qui pour ne rien arranger se trouve en compétition avec son voisin pour l’héritage symbolique de la Rus’ de Kiev.
Cette conjoncture amère s’ajoute d’ailleurs à une passion bien russe pour le rang, qui conduit à évaluer en permanence « lequel est le plus fort », à l’opposé du concept anglo-saxon de transaction « qui suppose une égalité sommaire entre les parties » [6]. Et, à ce jeu-là, la perception des diplomates du Kremlin est sans doute influencée par une vision essentiellement militaire de la puissance : dans un État qui s’affirme beaucoup plus par sa force brute que par sa capacité à penser le développement de la société, il pourrait difficilement en être autrement. En d’autres termes, même sans le contexte traumatique évoqué plus haut, la reconnaissance réelle des petits pays pose dans le cas russe une difficulté particulière [7] ; Staline, parlant du Vatican, disait déjà : « Le Pape, combien de divisions ? » – un exemple qui illustre combien cette tendance peut pousser à la myopie, si l’on pense au rôle de l’Église en Pologne dans les années quatre-vingt.
Un livre également édité par Diploweb.com via Amazon, format papier et format Kindle
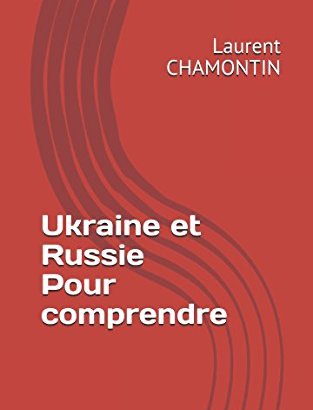
Laurent Chamontin, « Ukraine et Russie : pour comprendre. Retour de Marioupol », éditions Diploweb 2016. Un classique également disponible sur Amazon format papier et format Kindle
Le rôle des Occidentaux dans l’Étranger proche : les années Eltsine
L’apparition sur la carte des nouveaux États de l’Étranger proche est bien sûr riche d’opportunités pour les Américains et les Européens. Cependant, les années quatre-vingt-dix voient un démarrage assez lent du processus de recomposition, à mettre en relation avec l’extrême soudaineté de l’effondrement de l’URSS.
Du côté de la Russie elle-même, comme évoqué plus haut, c’est d’une phase de repli sur soi qu’il faut parler, même si le Kremlin parvient à conserver un certain nombre de points d’appui hors de ses frontières, en particulier à la faveur de conflits locaux (Tadjikistan, Karabakh, Transnistrie).
La décennie est pour Moscou le théâtre d’énormes problèmes économiques (récession dramatique en 1992, suivie d’une crise financière en 1998) et d’une évolution politique chaotique, sur fond de menaces de sécession. Celles-ci sont traitées de manière pacifique au Tatarstan, mais débouchent sur une guerre ouverte en Tchétchénie, que l’armée russe perd en 1996.
Les Américains de leur côté, dans ce qui est devenu une relation fortement dissymétrique, se préoccupent en premier lieu de la question la plus urgente [8] : la dénucléarisation des républiques ex-soviétiques. Sont concernés Kazakhstan, Biélorussie et Ukraine ; en ce qui concerne cette dernière, le processus est parachevé par la signature du mémorandum de Budapest en 1994, qui la voit renoncer à son armement nucléaire, en contrepartie d’une garantie de ses frontières par la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni.
Si des efforts sont faits pour atténuer la perte de statut de la Russie (intégration au G7 devenu G8, initiation d’un partenariat avec l’OTAN en 1997), cette époque voit aussi advenir certains événements qui pèseront lourd dans le contentieux futur, et dont il faut donc dire ici un mot.
L’élargissement de l’OTAN est le premier d’entre eux. Dans les années quatre-vingt-dix, il ne concerne encore que la Pologne, la Hongrie et la République Tchèque – l’intégration des pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) n’interviendra qu’en 2004, aux côtés de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Slovaquie et de la Slovénie. Le reproche, maintes fois réitéré ces dernières années, de la remise en cause d’une promesse faite à Mikhaïl Gorbatchev de ne pas procéder à cet élargissement n’est pas fondé et ne peut l’être, d’abord parce que ladite promesse n’a pas laissé de trace, et d’autre part parce que la question n’était tout simplement pas sur la table en 1990 [9].
Cette avancée consacre l’émergence dans le paysage de l’après-guerre froide des pays d’Europe centrale, qui voient dans l’adhésion à l’OTAN et à l’UE une garantie contre le retour de l’impérialisme russe. Ce point de vue va perdurer jusqu’à aujourd’hui, et infléchir de manière décisive les politiques occidentales vis-à-vis de l’Ukraine.
Autre dossier qui alimentera le ressentiment d’une Russie qui se perçoit comme ignorée par les Occidentaux : la guerre du Kosovo. Celle-ci survient à l’issue d’une décennie de violences dans l’ex-Yougoslavie, dans lesquelles le régime serbe, traditionnel allié de la Russie, porte une part de responsabilité importante. L’intervention de l’OTAN semble avoir reposé sur une surévaluation délibérée de la menace d’un nettoyage ethnique des Albanais par les forces serbes, l’objectif réel de l’opération étant d’en finir avec Slobodan Milošević, et a négligé à l’inverse les exactions commises sur les populations serbes à l’issue des combats [10].
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une intervention assumée sur le territoire d’un État souverain, qui convainc la diplomatie russe que les Occidentaux se sentent libres de s’affranchir des règles de l’ONU.
La reconnaissance de l’indépendance du Kosovo par les États-Unis et la plupart des pays européens en 2008 ne fera que conforter ce point de vue ; elle fournira à la Russie des prétextes d’ingérence dans l’Étranger proche (contestation de la souveraineté géorgienne en Abkhazie et Ossétie du sud, de celle de l’Ukraine en Crimée), sur des bases juridiques toutefois bien plus incertaines que dans le cas qui nous occupe.
Apparaît au passage, à cette occasion ; un problème que l’on retrouvera en travers de toute tentative de coopération avec la Russie au Moyen-Orient : celle-ci entretient des relations proches avec des régimes que l’Occident considère, à juste titre, comme peu fréquentables. Non que tous les États alliés des Occidentaux soient tous des modèles de démocratie : ce que l’on pointe ici, c’est une latitude diplomatique beaucoup plus grande de la Russie dans ce domaine, en raison d’une indifférence marquée aux questions liées aux droits de l’Homme.
Dernier élément notable à émerger dès les années quatre-vingt-dix de la concurrence entre Russes et Occidentaux dans l’Étranger proche, la question des approvisionnements pétroliers depuis le bassin de la mer Caspienne. La solution adoptée privilégie sans surprise une voie qui contourne la Russie, sans pouvoir tout à fait se soustraire à son influence : depuis la guerre de 2008 contre la Géorgie, l’Oléoduc Bakou – Tbilissi – Ceyhan qui amène le pétrole d’Azerbaïdjan en Méditerranée se retrouve à portée des canons russes.
Au total, au tournant du siècle, si les Américains reconnaissent que Moscou peut en certains cas entraver la poursuite de leurs intérêts et agissent en conséquence, ils se sont habitués à l’idée « qu’une Russie faible est disposée à acquiescer à leurs priorités » [11]. La réaffirmation de la puissance russe, esquissée avec la nomination d’Evguéni Primakov au poste de ministre des affaires étrangères en 1998, confirmée avec l’élection de Vladimir Poutine en 2000, va peu à peu contredire cette illusion.
Le rôle des Occidentaux dans l’Étranger proche : les années Poutine
Cette divergence progressive est d’abord masquée par une brève lune de miel, après les attentats du 11 Septembre 2001 : le président russe met alors la conjoncture à profit pour se positionner en partenaire incontournable des États-Unis, en faisant valoir le poids de son pays en Asie Centrale, proche de l’Afghanistan où les Américains portent leurs efforts. Il en profite également pour donner un vernis de légitimité à sa propre intervention contre le « terrorisme » en Tchétchénie, d’une brutalité sans égale.
L’embellie est de courte durée : dès 2003, l’engagement de Washington en Irak est décidé sans tenir le moindre compte des intérêts russes ni lui témoigner la moindre considération ; de plus, les frictions s’accumulent au sujet de la présence des États-Unis en Asie Centrale, des lenteurs de l’intégration de la Russie dans l’OMC, et du partenariat nucléaire qu’elle entretient avec l’Iran [12].
La contradiction s’exaspère encore avec les révolutions de couleur qui surviennent en Géorgie, en Ukraine et au Kirghizstan en 2004 et 2005. Le soutien de Washington à des mouvements désireux d’en finir avec la corruption et le népotisme post-soviétiques est tout à fait visible, même s’il convient de ne pas oublier le rôle d’organisations non gouvernementales comme la fondation de George Soros [13]. Quoi qu’il en soit, ce sont les électeurs qui votent, et ils choisissent de favoriser les mouvements en question.
Dans le même temps, les pays baltes adhèrent à l’OTAN, puis à l’UE, ce qui, du point de vue russe, est loin d’être anodin (la frontière estonienne est à environ 150 kilomètres de Saint Pétersbourg).
L’Étranger proche devient à ce moment-là un terrain de confrontation entre la Russie et les États-Unis, ce qu’il restera jusqu’à aujourd’hui.
Il faut se garder à ce sujet des jugements simplistes : certes, l’engagement progressif dans le « Freedom agenda » d’une administration américaine notoirement mal inspirée contribue inutilement à braquer le Kremlin. C’est d’autant plus vrai que certaines déclarations comme celle de G. W. Bush en 2006 à propos de l’Azerbaïdjan (« un pays musulman moderne qui est capable de pourvoir aux besoins de ses citoyens, qui comprend que la démocratie est la vague du futur [14] ») font voir crûment que les intérêts pétroliers conduisent à une indulgence coupable pour des pays franchement autoritaires, qui n’ont pas à endurer les leçons servies à la Russie.
Cependant, dès cette époque, Moscou prend la fâcheuse habitude d’un conservatisme sans issue, en soutenant jusqu’au bout des candidats grevés de tous les travers des bureaucraties post-soviétiques, alors que c’est bien la nécessité criante de la modernisation institutionnelle qui donne leur écho aux révolutions de couleur.
Le dialogue de sourds va s’aggravant avec le discours de Munich de Vladimir Poutine (2007), où celui-ci, rebuté par une collaboration avec l’Ouest à laquelle il ne trouve pas de fruits et porté par une conjoncture économique favorable, prend spectaculairement ses distances avec l’idée d’un monde unipolaire dominé par les États-Unis. Les Occidentaux, de leur côté, continuent d’envisager une adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie à l’OTAN, même si leurs divisions lors du sommet de Bucarest ne leur permettent pas d’engager les procédures idoines (2008).
La même année, éclate la guerre de Géorgie, qui leur fait comprendre que le discours de Munich n’était pas fait de paroles en l’air, et met un coup d’arrêt brutal aux perspectives d’élargissement de l’Alliance atlantique.
Dans l’Étranger proche, les années qui suivent voient essentiellement la mise en place du partenariat oriental entre l’UE, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine (2009), qui aboutira quatre ans plus tard au fameux sommet de Vilnius, auquel Viktor Yanoukovitch fera faux bond, déclenchant ainsi la révolution ukrainienne. Le lancement de ce processus signale en particulier l’émergence de la Pologne dans une UE dont l’équilibre a été modifié par les élargissements de 2004 et 2007 ; Moscou considère avec une inquiétude croissante la perspective de voir ses voisins, et en particulier Kiev, rejoindre un système qui serait incompatible avec son propre projet d’Union Eurasiatique.
Sur le plan énergétique enfin, il faut mentionner le démarrage du gazoduc Nord Stream en 2012, lequel permet à la Russie d’approvisionner l’Allemagne sans passer par l’Ukraine, la Biélorussie ou la Pologne, et donc d’augmenter ses marges de manœuvre dans les relations bilatérales avec ces pays.
Sur un plan plus global, l’arrivée au pouvoir de Barack Obama et sa politique de « reset » n’ont pas concrétisé les espoirs, au-delà de la signature d’un nouveau traité START sur le désarmement. Si la coopération continue sur le dossier du nucléaire iranien, les rancœurs laissées par l’élargissement de l’OTAN demeurent, même si celle-ci prend soin de ne pas déployer de troupes à proximité des frontières russes ; en sens inverse, la proposition faite par Dmitri Medvedev en 2009 de redéfinition de l’architecture de sécurité européenne ne rencontre pas d’écho, car elle va à l’encontre des prérogatives de l’OTAN comme de l’OSCE – l’organisation issue de la conférence d’Helsinki de 1975, compétente en matière de sécurité en Europe, mais aussi en matière de droits de l’Homme [15]…
Il en est de même au sujet de la défense anti-missiles déployée par les Américains depuis l’administration Bush, qui vise en fait l’Iran mais doit être déployée en Europe de l’Est. Cette perspective est mal accueillie par une Russie pour qui la parité avec les États-Unis dans le domaine des missiles nucléaires est l’un des rares domaines où elle peut encore faire valoir le statut qui était le sien du temps de l’URSS.
Il faut enfin mentionner la question des printemps arabes, où la coopération avec la Russie s’avère particulièrement épineuse, pour plusieurs raisons. D’une part, celle-ci conserve des clients jugés avec raison peu recommandables par l’Occident, en particulier Bachar El Assad, qui lui fournit aussi un point d’appui non négligeable en Méditerranée avec les installations de Tartous et Lattaquié. D’autre part, l’intervention de l’OTAN en Lybie a privilégié une interprétation très extensive de la résolution 1973 des Nations unies, conduisant de fait à un changement de régime, ce qui ruiné un peu plus la confiance avec Moscou [16].
En bref, à la veille de la révolution ukrainienne, les relations entre Russes et Occidentaux sont pour le moins laborieuses. Y ont contribué la maladresse, la naïveté ou le cynisme de ces derniers, et leur pratique du double langage, à des degrés divers ; Isabelle Facon pointe avec raison une atmosphère de suffisance dans les années quatre-vingt-dix qui a conduit à croire un peu vite que la Russie avait dit son dernier mot [17].
Il faut évoquer aussi, en arrière-plan, des facteurs structurels du côté de Washington et de ses alliés : d’abord le nombre d’acteurs en présence, et la complexité institutionnelle que crée la coexistence de l’OTAN et de l’UE, laquelle peine notoirement à s’imposer sur les questions de diplomatie et de défense.
À mentionner enfin un point particulièrement important pour la suite : à partir de l’élection de Barack Obama, et malgré les vicissitudes de son « pivot vers l’Asie », s’affirme une tendance à l’effacement des États-Unis : ceux-ci sont en effet nettement moins concernés que les Européens par les relations économiques avec Moscou et se sont affranchis de la dépendance vis-à-vis du pétrole du Moyen-Orient grâce au développement des hydrocarbures non conventionnels [18], ce qui leur permet de mieux se concentrer sur la montée en puissance de la Chine.
Du côté de Moscou, comme évoqué plus haut, le soutien systématique aux forces les plus rétrogrades des sociétés post-soviétiques et moyen-orientales a également joué son rôle, en ce qu’il traduit un manque complet de vision et de rayonnement, que la suite ne fera que confirmer.
Il faut finalement noter un point, que la propagande russe a contribué à obscurcir : si l’ambiance en 2013 est loin d’être constructive autour de l’Étranger proche, cela ne signifie en aucun cas que l’Occident menace militairement la Russie. De fait, rien n’est plus éloigné des préoccupations de nos sociétés post-héroïques, alors que la plupart des membres de l’OTAN sont fort loin de consacrer à leur défense les 2 % du PIB préconisés par l’organisation, et que celle-ci s’est judicieusement abstenue de déployer des troupes à proximité des frontières russes. On parle bien de luttes d’influence, non d’affrontement armé.
De manière somme toute logique, la crise va éclater dans un de ces nouveaux pays que Moscou a du mal à prendre au sérieux, dont la taille est cependant respectable à l’échelle européenne, un pays paradoxalement assez démocratique et ouvert sur l’Europe, mais aussi appauvri et fort corrompu : l’Ukraine.
Copyright 2016-Chamontin/Diploweb.com
Publication initiale sur Diploweb.com 24 août 2016
Table des matières
Introduction. Ukraine et Russie : pour comprendre. Retour de Marioupol
1 - Aux racines du conflit : la décomposition de l’URSS
2 - Géopolitique de l’"Etranger proche"
3 - L’Ukraine : émergence d’un nouvel État-nation
4 - "Euromaïdan" : une lame de fond
5 - Russie : les risques d’une puissance instable
6 - La guerre de l’information à la russe, et comment s’en défendre
7 - Les opinions européenne et française dans la guerre hybride
Conclusion. Le rôle crucial de l’Europe dans la résolution de la crise ukrainienne
Bonus cartographique
Pour ne rien rater de nos nouvelles publications, abonnez-vous à la Lettre du Diploweb !
[1] Entrée « зарубежье », « Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова », version en ligne http://slovarozhegova.ru (en russe).
[2] Sophie TOURNON, « Retour sur le concept d’un Étranger proche russe », 15 décembre2010, Regard sur l’Est, http://www.regard-est.com/home/breve_contenu_imprim.php?id=1134 .
[3] Hélène Carrère d’Encausse, L’empire éclaté, Flammarion, 1978.
[4] En matière de culture politique, cf. les classements de « Nations in transit », http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2014#.VE0L9kvbkb8 .
[5] René CAGNAT, « Où va l’Asie centrale ? Entre Chine, Russie et Islam », Diploweb, 1er juin 2014, http://www.diploweb.com/Ou-va-l-Asie-centrale.html .
[6] Hedrick SMITH, The Russians, Quadrangle / The New York Times Book Co., 1975, trad. française : Les Russes – la vie de tous les jours en Union Soviétique, Belfond, 1976.
[7] Développement inspiré par une réflexion de Jean-Marc HUISSOUD lors du Festival de Géopolitique de Grenoble (2014).
[8] Angela STENT, The Limits of Partnership : U.S.-Russian Relations in the Twenty-First Century, Princeton University Press, 2014.
[9] Angela STENT, op . cit. Cependant, la promesse de ne pas étendre l’OTAN à la RDA semble bien avoir été faite.
[10] Jean-Arnault DÉRENS, Le piège du Kosovo, Non Lieu, 2006.
[11] Angela STENT, op.cit.
[12] idem
[13] idem
[14] G.W. Bush en 2006 (Angela STENT, op.cit.)
[15] Angela STENT, op. cit.
[16] Denis BAUCHARD, ancien ambassadeur de France en Jordanie, conseiller auprès de l’IFRI, rencontre « Le retour de la Russie au Moyen-Orient », iReMMO, 3 Mai 2016.
[17] Préface à Laurent CHAMONTIN, op. cit.
[18] Angela STENT, op. cit.








